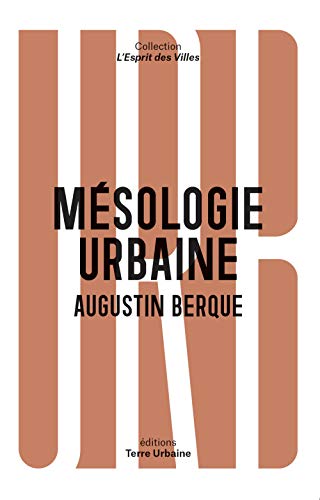MJ LAB partage sa note de lecture de l’œuvre d'Augustin Berque intitulée Mésologie urbaine.
Note de lecture : Augustin Berque, Mésologie urbaine, Editions Terre Urbaine, AsM Editions, Collection L’Esprit des Villes, 2021, 142 pages
Évoquer le travail du géographe, orientaliste et philosophe Augustin Berque peut surprendre. En effet, en quoi un ouvrage qui apporte de nouvelles réflexions sur notre manière d’habiter la Terre peut-il intéresser un site comme le nôtre consacré au « prendre soin » et aux objets techniques qui peuvent s’y inscrire ? La réponse se trouve dans une notion que notre laboratoire de recherche vise actuellement à conceptualiser : l’aménagement. Et plus précisément : l’aménagement du soin. Comme nous avons déjà commencé à le développer dans une intervention et un article, nous pensons que la situation de soin ne peut être appréhendée que de manière locale et à travers des processus dynamiques dont on ne peut évacuer ni les tensions ni le caractère inachevé. A ce titre, le point de vue avancé par A. Berque offre des pistes précieuses. Tentons par conséquent d’en dégager certains éléments, sans toutefois entrer dans les détails que nous invitons les lecteurs à découvrir.
Qu’entend au juste A. Berque avec le terme de mésologie ? De manière simple, on peut rappeler qu’il renvoie à l’ « étude des milieux ». Mais cela ne peut suffire, il faut encore tenter de comprendre ce que cette notion de « milieu » cherche à attraper. L’auteur retrace à cet effet l’histoire du mot « mésologie », de sa création en 1848 par le disciple d’A. Comte Charles Robin à sa reprise actuelle et son changement de sens, en passant par son effacement au profit du terme d’écologie (Ökologie) proposé quelques années plus tard par E. Haeckel. Ce sont surtout les travaux du biologiste et philosophe allemand Jakob von Uexküll qui permettent de saisir le sens que A. Berque souhaite apporter à ce mot. Uexküll propose en effet de faire une distinction essentielle entre l’Umgebung (données brutes de l’environnement) et l’Umwelt (milieu, monde ambiant). De quoi s’agit-il ? Pour le dire comme ça, s’il y a un environnement donné commun à toutes les espèces (Umgebung), il n’existe cependant pas de la même manière pour chacune d’entre elles. Car en fonction de leurs caractéristiques propres, les êtres vivants interprètent ce donné environnemental. De fait, seuls certains éléments de l’environnement peuvent, pour des raisons qui leur sont propres, devenir des prises pour ces derniers (ce que J. Gibson appelait des affordances). S’ensuit une conséquence majeure : à un même entourage correspond des milieux bien différents. Dit encore autrement : il y a autant de milieux que d’espèces. A plusieurs reprises, A. Berque donne l’exemple de la même touffe d’herbe, obstacle pour la fourmi, aliment pour une vache, abri pour un scarabée, etc. Aussi convient-il de penser que l’être vivant et le milieu se présentent comme nécessairement ajustés l’un à l’autre. A. Berque, après tout un effort de traduction d’un texte du philosophe japonais Watsuji Tetsurô, parle de médiance pour rendre compte de ce couplage dynamique de l’être vivant et du milieu : « sujet et objet se supposent et se co-suscitent l’un l’autre. » (p.9) Pour cette raison, la réalité est dite trajective, c’est-à-dire ni « purement objective (l’en-soi de l’objet), ni purement subjective (auquel cas ce ne serait qu’un fantasme) ; allant et venant entre ces deux pôles théoriques » (p.9). Et si les êtres humains ont aussi un milieu, il faut toutefois considérer que ce milieu est spécifique, en ce que ces derniers font intervenir dans leur rapport au monde des systèmes techniques et symboliques. Voilà ce qui fait de tout milieu humain une écoumène (l’ « habitée », oikoumenê, ensemble des milieux humains), nous dit A. Berque. Voilà ce qu’est habiter la Terre.
Insistons quelque peu. Les choses n’existent donc jamais comme choses-en-soi, mais toujours en tant que quelque chose, cet « en tant que » étant à lire comme une relation. Dans le but de ramasser ces réflexions, l’auteur propose alors l’équation suivante : « r = S / P ». On peut la lire ainsi : la réalité est S (le sujet, ce dont il s’agit, l’en-soi de l’objet, l’environnement donné) en tant que P (le prédicat, ce que l’on dit du sujet, la manière de saisir S propre à chaque être). Comme le montre l’exemple de la touffe d’herbe, S (l’herbe) ek-siste, hors de son en-soi, pour devenir une certaine chose selon l’être concerné : un obstacle (pour la fourmi), un aliment (pour la vache), etc. (p. 24) Car si S existe en tant que P, c’est toujours en fonction d’un certain interprète (I). A cet égard, un autre exemple, celui du pétrole, est également parlant : en soi, il n’est en rien une ressource (il ne l’était pas pour les Inuits qui l’avaient sous leurs pieds depuis des lustres) ; il ne peut le devenir que pour une civilisation qui a inventé le moteur à explosion et la pétrochimie (p. 53). On obtient alors une ternarité (S-I-P) qu’il faut appréhender comme étant mouvante dans l’espace (selon I : une vache, une fourmi, etc.) et dans le temps (chaque génération hérite d’une réalité qu’elle interprète à son tour à sa façon). En résumé, ce à quoi invite l’approche mésologique, c’est à se demander pour chaque élément de l’environnement s’il existe pour tel ou tel individu, ou pour tel ou tel groupe humain.
Bien plus. Elle souligne aussi l’exigence de ne pas laisser la prédication (ce qu’on dit du sujet) tourner à vide, s’hypostasier en oubliant ce qui lui sert de référence. « C’est en vertu de cette logique, écrit alors A. Berque, que tant de groupes humains se sont absolutisés en s’appelant eux-mêmes « les Humains », comme s’ils relevaient seuls de cette condition universelle. Ce faisant, ils « engloutissaient » l’humanité dans les termes singuliers de leur propre champ prédicatif : leur monde engloutissait le monde. » (p. 70) En d’autres termes, nous dit le géographe, il s’agit de garder les pieds sur terre !
Nous ne présentons ici que les prémisses d’une réflexion riche qui, au cours des six essais présentés, étendent leurs conséquences sur bien d’autres domaines tout aussi passionnants, notamment par des comparaisons entre l’Orient et l’Occident, tels que la distinction entre dedans et dehors, certes universelle, mais qui s’établit différemment selon les milieux, les définitions du public, du privé et du commun, le nouage des valeurs humaines qui imprègnent le milieu (le Bien, le Beau, le Vrai, fondant respectivement l’éthique, l’esthétique et soit la religion soit la science) et l’architecture post-moderne qui les désintrique, etc. C’est d’ailleurs sur une remarque relative à ce dernier terme que nous souhaitons terminer cette courte note de lecture. En effet, en rappelant que l’architecture doit prendre en compte la ternarité S – I – P, A. Berque met à jour deux principes que nous pourrions rapprocher des analyses de B. Latour :
- Le premier : l’architecture doit pouvoir se référer à la Terre (S). Pour cette raison, dans l’objectif de bâtir un monde humain, elle doit monter du sol d’un milieu concret et non pas descendre des étoiles d’une simple représentation (P). Mais fonder P sur S, ajoute-t-il, ce n’est pas réduire P à S : « c’est une assomption de S en P » (p. 128).
- Le second : l’architecture ne peut se limiter à un jeu de formes (P). Il s’agit de prendre en compte l’histoire du milieu, ses valeurs esthétiques et éthiques.
A survoler ces quelques courtes indications concernant cet épatant recueil de textes, le lecteur aura sans doute compris les biens que nous pouvons y trouver pour notre propre travail : en institution, penser le « prendre soin », penser son aménagement, penser l’inscription de certains objets techniques en son sein, demandent, à notre avis, ce même parti pris qu’est penser la réalité en tant qu’interprétée par chacun des protagonistes, de sortir des évidences de l’universel, des abords abstraits. Les apports d’A. Berque peuvent dès lors être tout à fait rapatriés dans notre champ. Il suffit, pour s’en rendre compte, par exemple, de relire cette note avec cette idée du lieu de soin et des mille façons de l’interpréter selon la place qu’on y occupe (soignant / soigné, ou bien encore soignant / administratif, pour le dire vite), les difficultés ou non que l’on peut rencontrer dans nos modes d’agir ou de parler, etc. En somme, « r = S / P » est une équation à retenir pour appréhender le « prendre soin ».